Everybody
L'exposition
Partant du corps comme dénominateur commun de toute destinée humaine, les deux commissaires d’Everybody, Richard Schotte et Sophie Warlop – par ailleurs directrice du LAAC–, en explore la présence dans l’art depuis les années 1950 en quelques 70 œuvres, depuis la peinture toute en fluides organiques de Paul Rebeyrolle jusqu’aux figures mécanisées de Maurizio Cattelan. Autant d’exemples brillants qui voient le corps frotté tour à tour à son image, à sa chair, à ses gestes et à l’objet manufacturé, pour en arpenter le territoire, à la suite de l’affirmation du sculpteur Antony Gormley – le corps est un endroit plus qu’un objet.
S’ouvrant dans l’espace central du LAAC – un vaste atrium avec ses gradins rappelant que l’institution artistique se doit d’être un espace de débat, où une barque chargée de ballots installée par Barthélémy Toguo évoque le destin des migrants et l’humanité de celui-ci –, le parcours d’Everybody est scandé par une série de salles dont les titres étreignent corps social et physique. L’effet miroir est la première, scrutant le « je est un autre » de toute représentation figurée : les photographies de fragments de corps à arpenter signées John Coplans jouxtent Self Hybridation, autoportrait hybride d’Orlan en 1998, où l’artiste pervertit son identité pour mieux en démultiplier les possibles, mêlant l’image de son visage avec celles d’autres femmes. Mariage et identification à l’autre se voit également traduite sur le mode de la gémellité par les photographes Butz&Fouque, tandis que les commissaires sont allés exhumer l’antimodernité de Roger Edgar Gillet, mort en 2004 et qui peignait les poux comme les humains, dont les empâtements d’une toile de 1977 exhibent la solitude complice d’un vieux couple qui s’épaule, fait de la même matière épaisse, selon Sophie Warlop. La salle suivante laisse le corps absent et montre tout ce qui lui est accessoire et peut le définir. Un assemblage de dessous de femmes devient tableau avec Gérard Deschamps – ce peintre sans pinceaux un temps proche des Nouveaux Réalistes –, le pantalon que portait Josef Beuys pendant une performance rappelle qu’une action militante vient aussi d’un corps ou le Plongeoir de Philippe Ramette esquisse par la négative le geste mental d’un saut dans le vide. C’est surtout les sculptures d’Erwin Wurm qui retiennent l’attention. La commissaire rappelle que l’artiste autrichien notamment connu pour ses One minute sculptures fait partie, au même titre que Rebeyrolle ou Dubuffet, de ceux qui ont poussé avec le plus de pertinence la traduction de l’image du corps. Invisible, l’anatomie cède le pas à l’objet, dans trois sculptures aux formes molles ou indexées à leur contenant. Rebeyrolle et Dubuffet sont d’ailleurs présents dans la section suivante, marquée d’une présence primitive, ou plutôt primordiale de l’humain, éclaboussé et souffrant chez le premier des deux, avec son superbe Homme saignant du nez de 1983. Les icônes tramées dans Gabrielle d’Estrées (1965) d’Alain Jacquet reprennent la structure du célèbre portrait anonyme de la favorite d’Henri IV, appelant une vue critique du continuum entre la femme fertile renaissante et la femme objet des Trente Glorieuses. Là encore, c’est de la chair et de son usage qu’il s’agit, bien que transposée dans les codes de l’efficacité publicitaire : les œuvres de Gérard Schlosser ou de Jacques Monory attenantes sont chargées, au même titre que pouvait l’être les Vénus du Cinquecentto, de l’humeur du désir. En amont d’un espace consacré à la documentation de la variété des expressions d’un corps à habiter – dans le cinéma, la danse, mais aussi la gastronomie –, on trouve la grande fresque au poing et au gant du Japonais Ushio Shinohara, résultante énergique d’un combat de boxe de l’artiste contre la toile. Vecteur de geste donc, visible dans les terres cuites malaxées par Mark Brusse, ou moyen de se mesurer, avec l’étalon de Stanley Brouwn, dont l’aspect minimaliste n’en réduit pas la portée physique. Un beau tableau d’Olivier Debré de 1959, appartenant aux collections du LAAC, rappelle que l’amplitude que le lieu propose en explorant des formes depuis les années 1950 jusqu’à aujourd’hui est une spécificité gage d’une appréhension large de l’art de notre époque.
Tom Laurent
S’ouvrant dans l’espace central du LAAC – un vaste atrium avec ses gradins rappelant que l’institution artistique se doit d’être un espace de débat, où une barque chargée de ballots installée par Barthélémy Toguo évoque le destin des migrants et l’humanité de celui-ci –, le parcours d’Everybody est scandé par une série de salles dont les titres étreignent corps social et physique. L’effet miroir est la première, scrutant le « je est un autre » de toute représentation figurée : les photographies de fragments de corps à arpenter signées John Coplans jouxtent Self Hybridation, autoportrait hybride d’Orlan en 1998, où l’artiste pervertit son identité pour mieux en démultiplier les possibles, mêlant l’image de son visage avec celles d’autres femmes. Mariage et identification à l’autre se voit également traduite sur le mode de la gémellité par les photographes Butz&Fouque, tandis que les commissaires sont allés exhumer l’antimodernité de Roger Edgar Gillet, mort en 2004 et qui peignait les poux comme les humains, dont les empâtements d’une toile de 1977 exhibent la solitude complice d’un vieux couple qui s’épaule, fait de la même matière épaisse, selon Sophie Warlop. La salle suivante laisse le corps absent et montre tout ce qui lui est accessoire et peut le définir. Un assemblage de dessous de femmes devient tableau avec Gérard Deschamps – ce peintre sans pinceaux un temps proche des Nouveaux Réalistes –, le pantalon que portait Josef Beuys pendant une performance rappelle qu’une action militante vient aussi d’un corps ou le Plongeoir de Philippe Ramette esquisse par la négative le geste mental d’un saut dans le vide. C’est surtout les sculptures d’Erwin Wurm qui retiennent l’attention. La commissaire rappelle que l’artiste autrichien notamment connu pour ses One minute sculptures fait partie, au même titre que Rebeyrolle ou Dubuffet, de ceux qui ont poussé avec le plus de pertinence la traduction de l’image du corps. Invisible, l’anatomie cède le pas à l’objet, dans trois sculptures aux formes molles ou indexées à leur contenant. Rebeyrolle et Dubuffet sont d’ailleurs présents dans la section suivante, marquée d’une présence primitive, ou plutôt primordiale de l’humain, éclaboussé et souffrant chez le premier des deux, avec son superbe Homme saignant du nez de 1983. Les icônes tramées dans Gabrielle d’Estrées (1965) d’Alain Jacquet reprennent la structure du célèbre portrait anonyme de la favorite d’Henri IV, appelant une vue critique du continuum entre la femme fertile renaissante et la femme objet des Trente Glorieuses. Là encore, c’est de la chair et de son usage qu’il s’agit, bien que transposée dans les codes de l’efficacité publicitaire : les œuvres de Gérard Schlosser ou de Jacques Monory attenantes sont chargées, au même titre que pouvait l’être les Vénus du Cinquecentto, de l’humeur du désir. En amont d’un espace consacré à la documentation de la variété des expressions d’un corps à habiter – dans le cinéma, la danse, mais aussi la gastronomie –, on trouve la grande fresque au poing et au gant du Japonais Ushio Shinohara, résultante énergique d’un combat de boxe de l’artiste contre la toile. Vecteur de geste donc, visible dans les terres cuites malaxées par Mark Brusse, ou moyen de se mesurer, avec l’étalon de Stanley Brouwn, dont l’aspect minimaliste n’en réduit pas la portée physique. Un beau tableau d’Olivier Debré de 1959, appartenant aux collections du LAAC, rappelle que l’amplitude que le lieu propose en explorant des formes depuis les années 1950 jusqu’à aujourd’hui est une spécificité gage d’une appréhension large de l’art de notre époque.
Tom Laurent
Quand
28/04/2016 - 18/09/2016
Les artistes

Mark Brusse

Jacques Monory

Jean Dubuffet
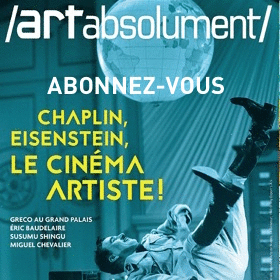 Publicité
Publicité
pubabbonnemenrt

Peter Klasen


